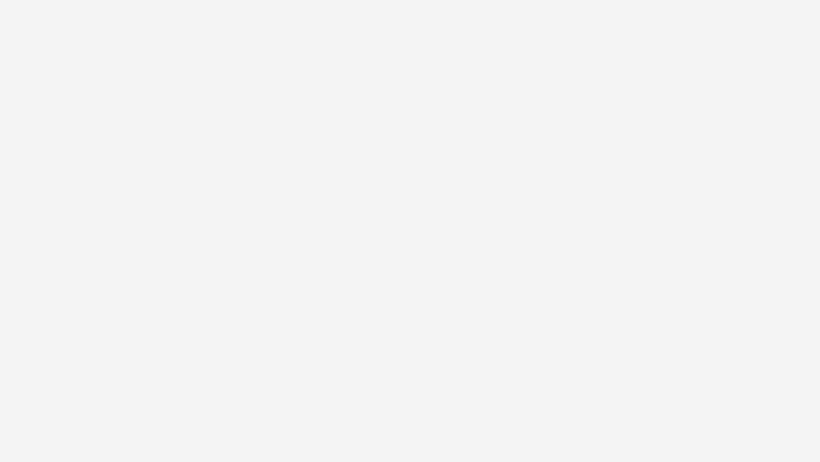Sous un soleil de plomb, des menuisiers, trempés de sueur, s’activent pour construire des planchers à grand coups de marteaux. A Kano, la grande ville du nord du Nigeria, un centre d’isolement flambant neuf pourra bientôt accueillir les patients du Covid-19.
Derrière cette initiative se trouve l’homme le plus riche d’Afrique, Aliko Dangote, dont la fortune est estimée à plus de 15 milliards de dollars (Bloomberg 2019). Deux immenses tentes blanches d’environ 250 lits ont été érigées sur le stade de foot de la cité commerçante qui a vu naître le roi du ciment.
Dans le pays anglophone de 200 millions d’habitants, des décennies de mauvaise gestion des pouvoirs publics ont laissé un système de santé exsangue, alors dans la lutte contre le coronavirus, comme bien souvent, le secteur privé est appelé à la rescousse.
Créée fin février, la Coalition du secteur privé contre le Covid-19 (Cacovid), pilotée par Dangote et le groupe bancaire nigérian Access Bank, rassemble une cinquantaine d’entreprises qui ont promis près de 22 milliards de nairas (57 millions de dollars) pour le pays, selon un document interne que l’AFP a pu consulter.
« Si chacun fait les choses dans son coin, ça crée une cacophonie, alors en fonction de sa taille, chacun met ce qu’il peut et on mutualise nos moyens », assure à l’AFP Zouera Youssoufou, directrice générale de la Fondation Dangote.
– La mobilisation s’accélère –
Le secteur privé va ainsi bâtir sept centres d’isolement dans les grandes villes (Kano, Lagos, Abuja, Maiduguri, Port-Harcourt…), et chercher à augmenter les capacités de diagnostique du Nigeria, qui n’a réalisé que 5.000 tests depuis le début de l’épidémie.
L’Afrique semble pour l’instant moins touchée que le reste du monde avec un total de quelque 16.200 cas officiellement recensés pour près de 900 morts, selon un décompte de l’AFP.
Mais les experts invitent à la prudence, estimant que l’ampleur réelle de la pandémie pourrait être sous-estimée – notamment en raison du manque de tests disponibles.
Alors, un peu partout, la mobilisation s’accélère. En Afrique du Sud, le magnat des mines, Patrice Motsepe (African Rainbow Minerals), de même que les familles Rupert (fonds d’investissement Remgro Limited) et Oppenheimer (diamants De Beers) ont chacun promis un milliard de rands (53,3 millions de dollars).
A l’échelle continentale, la Banque africaine de développement (BAD) a annoncé la semaine dernière la création d’un fonds de 10 milliards de dollars pour soutenir les économies africaines.
Et l’Union africaine (UA) a lancé le 7 avril un fonds spécial contre le Covid-19 auquel les Etats membres ont déjà accepté de contribuer à hauteur de 17 millions de dollars.
– « Plan Marshall » pour l’Afrique –
« Nous devons maintenant (…) mobiliser toutes les ressources pour contenir cette pandémie et empêcher l’effondrement d’économies et de systèmes financiers déjà en difficulté », a déclaré dimanche le président en exercice de l’UA, le Sud-africain Cyril Ramaphosa.
Reste à convaincre les institutions régionales et internationales, mais aussi les milliardaires africains d’y participer. L’objectif du fonds spécial est de réunir à terme quelque 400 millions de dollars pour financer en priorité la réponse sanitaire, puis les économies.
Contacté par l’AFP, l’homme d’affaires et philanthrope nigérian Tony Elumelu, président de la banque UBA, présente dans 20 pays, appelle à un « plan Marshall » pour l’Afrique après avoir annoncé un don de 14 millions de dollars au Nigeria et au reste du continent.
« Il est urgent que les gouvernements africains et les partenaires internationaux intensifient leur programme de relance économique Covid-19 pour le continent » avec « une réponse internationale coordonnée », affirme-t-il
Toute la difficulté est de trouver de l’argent disponible rapidement. Les institutions, comme la Banque mondiale ou la BAD qui ont promis des milliards, sont soumis à des procédures contraignantes, et leurs aides mettent souvent plusieurs mois avant d’être débloquées.
Quant aux grandes fortunes, malgré leurs discours récurrents sur le panafricanisme, elles se montrent encore frileuse lorsqu’il s’agit d’élargir leur solidarité au continent.
– « Effets d’annonce » –
« Pour l’instant, personne n’a encore vraiment participé » explique sous couvert d’anonymat à l’AFP un haut fonctionnaire de l’UA. « Les plus enclins à donner et rapidement, ce sont les Chinois. C’est pour cela que nous avons reçu aussi vite des aides de Jack Ma », le fondateur du géant de la vente en ligne Alibaba.
« On aimerait que les milliardaires africains suivent l’exemple, malheureusement cela reste souvent des effets d’annonce », poursuit cette source. « En 2015 avec Ebola, beaucoup de promesses ont été faites, mais en dehors de Dangote et de Motsepe, très peu ont vraiment débloqué l’argent ».
Toutefois, le groupe Ecobank, qui possède des filiales dans une quarantaine de pays, s’apprête à lancer une plateforme de soutien aux PME africaines, selon la même source.
Du côté de l’empire Dangote, présent dans toute l’Afrique à travers des usines de ciment, de sucre, ou encore de farine, Zouera Youssoufou assure également vouloir « s’engager pour le continent » même si elle reconnait que priorité est pour l’instant donnée au Nigeria.
« Nous sommes panafricains par essence », dit-elle. « Mais on met d’abord son propre masque à oxygène avant d’aider les autres ».