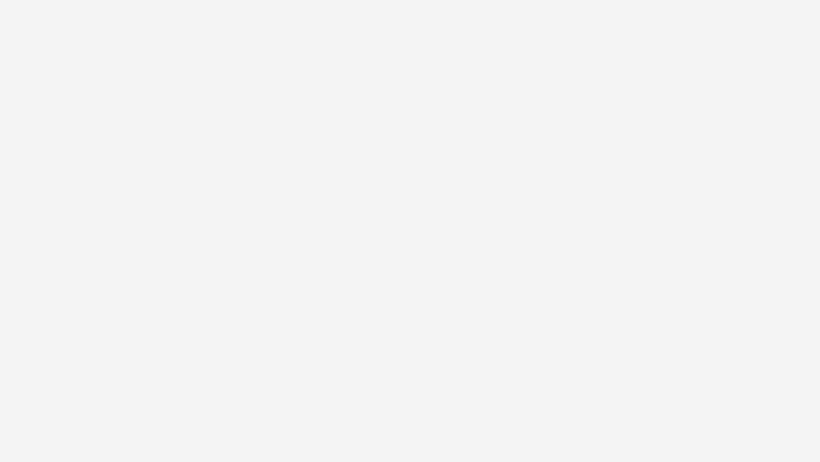Après avoir échoué à empêcher en décembre l’élection d’un successeur au président déchu Abdelaziz Bouteflika, le mouvement de contestation en Algérie, le « Hirak », s’interroge sur son avenir, confronté aux risques d’essoufflement face à un régime qui semble avoir repris la main.
Informel, non structuré, agrégeant autour de deux mots d’ordre essentiels –« Silmyia » (pacifique) et « Qu’ils partent tous! »– un éventail d’opinions disparates, voire de fractures idéologiques, le « Hirak » entre dans sa 2e année avec de nombreuses questions auxquelles il doit répondre rapidement.
Le mouvement est jeune, « tout s’y fait dans la spontanéité, la découverte, l’expérimentation mais aussi dans les clivages », explique à l’AFP Karima Dirèche, historienne spécialiste du Maghreb contemporain. « Il faut apprendre à écouter l’autre, à accepter qu’il soit d’un avis différent, apprendre à négocier des consensus. On n’y est pas encore ».
L’élection en décembre d’un nouveau chef de l’Etat, Abdelamdjid Tebboune, ancien cadre de la présidence Bouteflika et pur produit du « système », paraît avoir enterré la principale revendication du « Hirak »: la fin du régime au pouvoir depuis l’indépendance en 1962 et une « transition » vers des institutions nouvelles.
« La transition politique, on n’y est pas; on est en train d’y réfléchir » au sein de la contestation, assure Mme Dirèche, directrice de recherches au Centre national de recherche scientifique (CNRS, France).
Actuellement, « on est dans quelque chose de très bizarre: la mobilisation est toujours là (…), mais on voit bien qu’il y a une vraie difficulté à passer à autre chose » que ces rassemblements hebdomadaires, relève-t-elle.
– Importantes décisions –
Le « Hirak » doit-il négocier avec un président qui a dit « lui tendre la main »? Doit-il se structurer et désigner des représentants? Doit-il envisager d’autres modes d’action?
« Le mouvement a d’importantes décisions à prendre », confirme Dalia Ghanem, chercheuse au Carnegie Middle East Center de Beyrouth (Liban).
Ses militants ne sont unanimement d’accord que sur les deux principaux mots d’ordre, mais « pas sur les modalités (d’action) ni sur l’institutionnalisation (du mouvement), ni sur le leadership », note la chercheuse.
L’absence de chefs a beaucoup servi la contestation, jusque-là: « Puisqu’ils n’existaient pas, ils n’ont pas pu être incarcérés ni harcelés ou cooptés », comme le faisait le régime pour taire les oppositions, poursuit-elle. Mais cette absence de figures dirigeantes identifiées entrave la capacité du mouvement à négocier avec le pouvoir.
En Algérie, faute de véritables partis d’opposition, de syndicats et de médias indépendants, « les forces d’opposition et de contestation qui auraient pu prendre le relais » n’existent pas, souligne Karima Dirèche.
– Penser à « l’après » –
Pour Pierre Vermeren, professeur d’histoire contemporaine à Paris-I et spécialiste du Maghreb, « la seule option pacifique » pour la contestation « est de reconstruire des organisations politiques ou des associations civiles afin de préparer les élections locales et nationales » et avoir des élus capables de « relayer la parole du +Hirak+ dans les institutions ».
« Le problème est que, malgré leur goût de la chose politique, les Algériens ont une confiance très limitée dans les institutions existantes », constate-t-il.
Le mouvement commence néanmoins à se structurer au niveau local.
En face, le pouvoir est en pleine « régénération », avec un président à nouveau « façade civile d’un régime qui reste aux mains de l’institution militaire », analyse Dalia Ghanem.
Un pouvoir tenté de jouer le pourrissement alors que le « Hirak » n’a plus obtenu gain de cause depuis la démission du président Abdelaziz Bouteflika le 2 avril et le report d’une première tentative de scrutin présidentiel en juillet.
« Les dirigeants (algériens) savent très bien faire ça », observe Mme Dirèche.
En outre, « chaque mouvement social est par définition victime du temps et ne peut continuer éternellement », selon Dalia Ghanem: dès lors, « comment convaincre les gens de continuer à descendre dans la rue chaque vendredi? ».
Il faut donc penser à « l’après ».
Mais, traumatisés par des années de violence politique, les Algériens renâclent à d’autres modes d’actions, comme la grève générale ou la désobéissance civile. Chez les Algériens, « on réfléchit à deux fois avant la confrontation », note Karima Dirèche.
L’historienne ne croit pas à l’essouflement des marches: « Ce mode opératoire permet d’économiser ses forces ». Les défilés sont un moyen de « s’initier à la politique, chose interdite jusqu’à présent et absente des réseaux classiques, à l’école ou à l’université, dans les partis ».
« Les choses sont en train de s’apprendre, s’expérimenter, et bien évidemment tout cela va produire quelque chose. Mais quoi? Comment? Quand? Difficile à dire ».
Pour Akram Belkaïd, journaliste et essayiste algérien, « il faut s’inscrire dans le temps long ».
« Il y a des demandes, des exigences du peuple. Le +Hirak+ est un aiguillon. Il rappelle sans cesse que rien ne va. Tôt ou tard, le régime devra en tenir compte ».